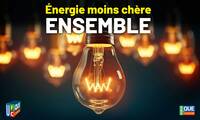Décidément, la réforme de la gestion de l’eau et de l’assainissement ne coule pas de source ! Après 10 années de débats animés déclenchés par la loi NOTRé (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), les députés ont adopté le 13 mars dernier un certain nombre de mesures visant notamment à annuler l’obligation pour les communes de transférer la gestion de l’eau et l’assainissement aux intercommunalités. Objectif premier : rendre aux communes leur liberté de choisir !
Une loi NOTRé toujours contestée
Considérée par certains parlementaires comme « un habile jeu d’amendements », ou bien encore « une décision hors-sol », cette loi adoptée en 2015, avait notamment pour ambition de transférer la gestion de l’eau et de l’assainissement aux seules intercommunalités. Exit la gestion communale !
Réalisée sans étude d’impact au moment de son adoption, la mesure de transfert obligatoire restait contestée par un grand nombre de communes qui considéraient que la gestion communale ou intercommunale existante donnait satisfaction et permettait de répondre aux enjeux actuels. Mais la loi NOTRé fermait les portes à des solutions de terrain parfois éprouvées depuis de longues années, sans possibilité de choix.
En 2023, seules 1/3 des communautés de communes, soit 329 d’entre elles sur 990, exerçaient la compétence « eau » selon la DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales) démontrant, pour le moins, une résistance à l’application du transfert de la gestion de l’eau.
Plusieurs dispositions législatives étaient déjà venues modifier l’application de cette loi et de son calendrier de mise en œuvre sans apporter de solution véritable.
Rendre leur liberté aux communes
 Si, comme l’a rappelé le député J-Luc WARSMAN, rapporteur de la proposition de loi, lors des débats, la loi NOTRé a bouleversé le système, cette nouvelle lecture de la loi initiée par le Sénat a pour objectif de « rendre la liberté à chaque commune d’exercer ou non la compétence eau, la compétence assainissement non-collectif, ou la compétence assainissement collectif ».
Si, comme l’a rappelé le député J-Luc WARSMAN, rapporteur de la proposition de loi, lors des débats, la loi NOTRé a bouleversé le système, cette nouvelle lecture de la loi initiée par le Sénat a pour objectif de « rendre la liberté à chaque commune d’exercer ou non la compétence eau, la compétence assainissement non-collectif, ou la compétence assainissement collectif ».
Situant ainsi le débat sous le signe de la « liberté de décision rendue aux communes et d’une confiance en leur capacité de décision », face à une loi imposée aux élus et interprétée comme « un signe supplémentaire du dérapage de pouvoirs publics nationaux, qui, considérant que les territoires ne savent pas comment organiser la vie locale, imposent une loi aux habitants et aux élus. »
Prendre en compte la diversité du territoire
 Qu’il s’agisse de « l’hydrographie et d’une organisation des bassins versants vieille de plusieurs décennies » les députés ont considéré qu’un « cours d’eau ne se plie pas à un périmètre administratif ». « La gestion de l’eau est différente selon que l’on se trouve en Savoie, dans les Landes ou en Île-de-France » ont rappelé d’autres députés. Pour au final, conclure que «l’égalité n’est pas l’uniformité territoriale» et que des compromis s’imposaient pour permettre aux communes et aux élus de mesurer si le transfert de l’eau était opportun ou non sur leur territoire.
Qu’il s’agisse de « l’hydrographie et d’une organisation des bassins versants vieille de plusieurs décennies » les députés ont considéré qu’un « cours d’eau ne se plie pas à un périmètre administratif ». « La gestion de l’eau est différente selon que l’on se trouve en Savoie, dans les Landes ou en Île-de-France » ont rappelé d’autres députés. Pour au final, conclure que «l’égalité n’est pas l’uniformité territoriale» et que des compromis s’imposaient pour permettre aux communes et aux élus de mesurer si le transfert de l’eau était opportun ou non sur leur territoire.
Eviter des effets induits
Parmi les arguments également avancés en faveur de l’annulation de l’obligation de transfert de l’eau aux intercommunalité figuraient deux autres points : l’augmentation des tarifs de l’eau liés à l’harmonisation tarifaire entre plusieurs territoires regroupés et le changement du mode de gestion avec le transfert éventuel à une société privée, sans pouvoir toujours effectuer de « constat d’amélioration du service ».
Quelles mesures ont été adoptées par les députés?
Il faut préciser tout d’abord que ces décisions votées à la quasi-unanimité (113 pour 3 contre) par l’Assemblée Nationale devront être confirmées par la C.M.P. (commission Mixte Paritaire) composé de sénateurs et de députés pour pouvoir être appliquées. Des évolutions ont été votées à l’Assemblée par rapport à la version de loi proposée par le Sénat et analysée dans le cadre de la « procédure accélérée », les parlementaires devront trouver des compromis et se mettre d’accord.
Par ailleurs, différents décrets devront être également pris par le pouvoir exécutif pour permettre leur application effective.
Le transfert obligatoire de l’eau et de l’assainissement aux communautés de communes au premier janvier 2026 ne sera plus une obligation pour les communes.
3 possibilités s’offriront aux communes qui n’ont pas encore transféré l’eau et l’assainissement :
– garder la compétence au niveau communal,
– transférer la compétence à un syndicat intercommunal choisi librement,
– transférer la compétence à la communauté de communes.

Diverses dispositions ont été également précisées par les députés.
– Possibilité de créer un syndicat « infracommunautaire » en matière d’eau et d’assainissement :
les communes pourront se regrouper au sein de syndicats intercommunaux inclus dans le périmètre de la communauté de communes (donc plus petits que la communauté de communes) pour gérer l’eau et l’assainissement.
Cette possibilité ne sera pas conditionnée par les décisions des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI).
– Possibilité d’études conjointes entre les communes et la communauté de communes pour la gestion de l’eau.
– Impossibilité de retour en arrière lorsque des décisions de transfert de l’eau et de l ’assainissement ont déjà été prises.
– Des conventions pourront être passées entre la communauté de communes et les communes pour la gestion de l’eau et de l’assainissement, y compris les eaux pluviales. Des études de gestion pourront être menées par les communes d’un « bassin versant » et la communauté pour la gestion de la ressource en eau et la sécurité du service (article 1).
– Le domaine de l’assainissement a été fractionné en 2 secteurs : assainissement collectif et assainissement non collectif permettant un transfert de l’un et/ou l’autre de ces domaines.
– Un débat obligatoire sera mené au sein du conseil municipal pour analyser la situation de la gestion de l’eau, à chaque début de mandat, et dans un délai de moins de 6 mois après les élections municipales. (article 3bis)
Avec pour objectif d’ »évoquer les enjeux relatifs à la qualité et à la quantité de la ressource en eau à l’échelle de la commune et à l’échelle du département, la performance des services, l’efficacité des interconnexions ainsi que les perspectives d’évolution à dix ans de ces différents éléments ».
– Un rapport détaillé sera établi par les services de la Préfecture sur les enjeux de la gestion de l’eau et de l’assainissement, avec la formulation de propositions facultatives pour l’organisation des collectivités. Une réunion par mandat communal sera mise en place pour la commission departementale de coopération intercommunale afin d’étudier ce rapport. Elle pourra « formuler des propositions non contraignantes sur l’organisation territoriale du département pour les compétences « eau » et « assainissement » à l’échelle du département. »
– Une solidarité « obligatoire » entre communes lorsque des problèmes de qualité ou de quantité d’eau surviennent pour la première fois sur un territoire. (article 5)
 Photos Jeep Ehaime
Photos Jeep Ehaime
Et des sujets qui tombent à l’eau…
L’article 4 de la proposition de loi qui donnait aux départements des capacités d’intervention dans la gestion de l’eau a été supprimé en raison notamment de la crainte de permettre « le déploiement d’ouvrages multi-usages et donc de méga-bassines ». (Mais d’autres textes législatifs liés aux orientations agricoles devraient permettre aux départements d’être acteurs en matière d’eau.)
Les députés ont également annulé l’article 6 qui prévoyait de supprimer les contrôles des installations d’assainissement non collectif (ANC) anciennes. Cette disposition ayant donné lieu à de nombreux échanges entre parlementaires, les uns, favorables à la suppression de ces contrôles car confrontés, selon eux, « à l’inefficacité des mesures de contrôle non suivies d’amélioration et coûteuses pour les abonnés au SPANC ».
Les autres, soucieux de maintenir ces contrôles afin de préserver la qualité sanitaire de l’environnement. Les activités de production de coquillages (huîtres et moules) étant particulièrement mises en avant car très sensibles à la qualité du milieu marin.
RAPPEL
Le texte, examiné en procédure accélérée, doit maintenant faire l’objet d’une commission mixte paritaire, Sénat et Assemblée. Le gouvernement s’est engagé à diligenter cette procédure.